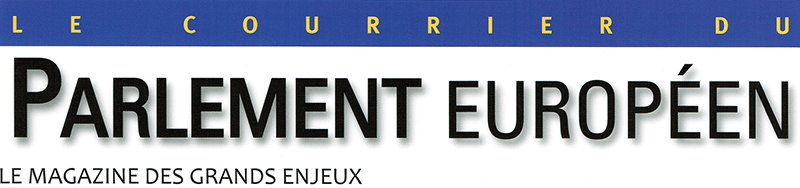Alors que débute la préparation de la conférence COP30 à Belem (Brésil) prévue le 10 novembre prochain, les ministres de l’Environnement des 27 États membres de l’Union européenne se sont retrouvés à Bruxelles pour tenter de s’entendre sur deux échéances majeures : une réduction des émissions d’ici 2035 et le vote d’une loi climat pour 2040. L’enjeu étant d’arriver au sommet avec un mandat crédible, sans lequel tous risqueraient un échec diplomatique retentissant.
L’édification d’un consensus constitue le fondement même de l’actualisation de la NDC (Nationally Determined Contributions) pour l’UE. Ce mécanisme correspond aux engagements auxquels consentent les pays membres, sous l’égide de Accord de Paris, pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et s’adapter aux effets du climat.
Initialement, la Commission proposait un plan pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 : un objectif remis en question par des contestations venant entre autres d’Hongrie, de Pologne, de Tchécoslovaquie et d’Italie. En témoigne notamment l’interdiction de la mise en circulation de véhicules à combustion dès 2035, qui se retrouve reléguée à plus tard. Et ce malgré la volonté de révolutionner le secteur automobile – soit le plus polluant actuellement – via le “New Small Affordable Car Initiative With Industry”. De quoi s’interroger sur les délais de la sortie de ce véhicule, sobrement baptisé “E-car” (avec un E pour environnementale, efficace, économique, électrique et européen).
Après plus de quinze heures de pourparlers, les 27 se sont finalement mis d’accord mercredi 5 novembre pour un projet commun portant sur 2035 et 2040. Celui-ci doit encore être faire l’objet d’une validation par le Parlement européen. De quoi offrir de solides perspectives d’ici la COP30, dont sera investie Ursula van der Leyen, présidente de la Commission européenne.
Les Nations unies estiment néanmoins que le monde reste sur une trajectoire de +2,5 °C d’ici 2100, loin de l’objectif de +1,5 °C fixé par l’Accord de Paris. “Si les plans climatiques nationaux ont permis quelques progrès” admet la directrice du Programme des Nations Unies pour l’environnement, Inger Andersen, il y a urgence à enclencher la seconde vitesse suite au constat d’“un rythme bien trop lent”. Pour ce faire, l’Europe doit se doter des moyens de ses ambitions avec un cadre juridique contraignant et impératif auquel nul Etat ne pourrait se soustraire.
Entre discussions et prises d’intérêt politique
Faisant désormais consensus (au moins sur papier), l’avenir de la problématique climatique ne manque pourtant pas d’incohérences lorsqu’il s’agit de sa mise en pratique. En témoigne notamment la transition vers la neutralité effective, qui passe par la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 90 % d’ici à 2040 par rapport à 1990. L’ajout d’une clause -défendue notamment par la France- permettant l’achat de crédits carbone à hauteur de 5% à l’étranger, interroge au même titre que les clauses de revoyure. De nature à rassurer les investisseurs et autres pays récalcitrants, elles n’en demeurent pas moins la preuve additionnelle d’une frilosité à l’idée de prendre résolument le pas de la décroissance. Alors même qu’en 1972, le célèbre rapport Meadows, intitulé The Limits to Growth, alertait déjà sur les conséquences de la croissance économique illimitée et de la surexploitation des ressources naturelles.
L’une des limites d’un tel dispositif résulte de la singularité du modèle de production énergétique d’un Etat à l’autre. A ce titre, la France revendique sa particularité fondée sur les énergies décarbonées, là où les défenseurs du climat et ONG optent de manière univoque pour les énergies vertes. En d’autres termes, Paris n’entend pas payer pour les Etats membres les moins performants sur la gestion des émissions de GES et encore moins se laisser stigmatiser. L’Hexagone essuie déjà des critiques suffisamment acerbes du Réseau Action Climat. Pour sa Responsable Europe, Caroline François-Marsal, “la France aura joué le mauvais rôle jusqu’au bout”, pointant du doigt l’introduction de “flexibilités” qui ralentissent le progrès en matière de transition.
L’enjeu climatique s’établit en effet à trois échelles, à commencer en interne – âpres négociations entre les Etats membres-, puis en externe – montrer un visage d’unité sur la scène internationale- mais aussi sur le fond en s’alignant avec l’objectif climatique global des accords de Paris qui préconisent une augmentation de 1,5 ° par rapport à l’ère préindustrielle).
Un leadership affaibli mais toujours vivant
Le commissaire européen au Climat Wopke Hoekstra a défendu pour sa part un “excellent texte de compromis”, estimant que l’Europe “doit garantir sa compétitivité climatique” en combinant réduction des émissions et maintien d’une industrie forte.
Des propos que rejoignent ceux du ministre danois du Climat Lars Aagaard, qui prêche l’affermissement “d’une Union plus forte, plus compétitive et plus sure”.
L’accord n’en demeure pas moins fragile et illustre très bien les divergences profondes qui subsistent entre les membres de l’UE. Trois Etats sur quatre du groupe de Visegrad ont ainsi rejeté la feuille de route pour 2040, tandis que la Bulgarie et la Belgique ont préféré s’abstenir. Et ce malgré une énième concession sur le report d’un an, de 2027 à 2028, de l’extension du marché du carbone au transport routier et au chauffage des bâtiments, demande portée par la Pologne et la Hongrie.