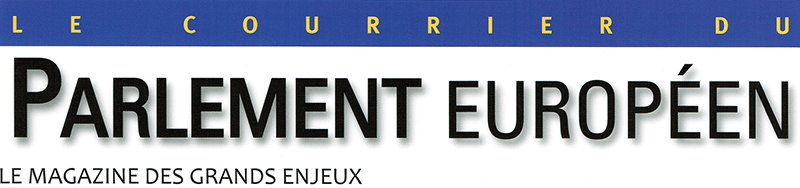Si les membres de l’Alliance de l’Atlantique Nord s’inquiètent des intimidations d’une Russie jugée de plus en plus provocatrice, Fabien Mandon, le chef d’état-major des Armées en France, n’exclut pas l’éventualité d’une offensive généralisée sur l’Europe. Il estime même que la France doit se tenir “prête à un affrontement dans trois ou quatre ans”.
Ces propos tenus en Commission de Défense à l’Assemblée nationale le 22 octobre dernier peuvent évidemment sembler alarmistes. En réalité, le chef d’état-major des Armées se veut avant tout préventif pour impulser un sursaut dans le cadre du vote du budget consacré à la Défense.
Celui-ci prévoit une hausse de 13% des dépenses militaires (+ 6,7 milliards) pour atteindre 57,1 milliards d’euros en 2026, consentant à un effort budgétaire de l’ordre de 2,2% du PIB. Alors que l’offensive russe en Ukraine s’intensifie ces derniers jours, le ministère russe de la Défense présente un décompte faisant état de 1 380 soldats ukrainiens tués la seule journée du samedi 25 octobre. Et une progression sur le terrain avec la prise de trois localités (Novomykolaïvka, Pryvilné et Egorivka) : Volodymyr Zelensky estime que l’armée russe a assailli l’Ukraine avec près de 1 500 drones, 1 170 bombes aériennes et plus de 70 missiles.
De nouvelles formes de pression
Depuis plusieurs années, la Russie multiplie aussi les moyens dits hybrides pour affirmer sa puissance face à l’Europe : survols de drones, opérations de sabotage, cyberattaques et campagnes de désinformation s’inscrivent dans une logique d’influence qui dépasse le cadre militaire classique. Cette stratégie trouve en partie sa légitimité dans la Constitution russe qui consacre “la défense de la patrie comme devoir de chaque citoyen” dans son article 59. Le 61ème poursuit que « la Fédération de Russie garantit à ses citoyens protection et patronage à l’étranger”. Si cette clause ne confère pas explicitement un droit d’intervention armée, elle alimente la rhétorique du Kremlin lorsqu’il affirme défendre les populations russophones au-delà de ses frontières, notamment en Ukraine.
La fin de la Guerre Froide devait clore le chapitre conflictuel sur le territoire européen, et le changement de cap de la Russie passait par son intégration réussie dans le concert des nations. D’abord cooptée au G7 devenue G8 dès Gorbatchev, elle participait aux meetings des grands pays démocratiques. Il en va de même de son accession aux principales institutions multilatérales que sont le FMI et le GBM (Groupe de la Banque Mondiale). Au niveau régional, la Russie avait rejoint le Conseil de l’Europe (OIG pan-européenne de 47 membres créée en 1949) qui s’étendait de l’Irlande à l’Ukraine et du Portugal à la Finlande. C’est dans cette dynamique similaire que l’union internationale contre le terrorisme, désigné ennemi commun, a vu Poutine assurer Bush de son soutien en 2001.
Mais suite à l’exclusion de la Russie du G8 et l’invasion de la Crimée en 2014, les tensions avec des séparatistes pro-russes en Géorgie et le conflit en Syrie n’ont eu de cesse d’éloigner diplomatiquement européens et russes. Et ce malgré des tentatives d’apaisement et de retour au dialogue avec les protocoles de Minsk I et II.
Le point d’orgue de cette rupture est intervenu le 10 novembre 2021, avec la signature de la Charter on Strategic Partnership scellant une coopération militaire et sécuritaire accrue entre Washington et Kiev. Cet accord est perçu comme un casus belli par Moscou, puisqu’il ouvre à Kiev la porte de l’entrée à terme dans l’OTAN. Depuis, la rupture diplomatique est consommée et le Kremlin justifie ses actions par la nécessité de préserver sa sécurité et son « espace d’influence », considérant tout rapprochement euro-atlantique comme une alliance implicite à peine dissimulée.
L’idée d’un “droit de protection” des citoyens russes sert de cadre idéologique à cette politique d’expansion, tout comme la doctrine de guerre hybride, conceptualisée dans la pensée stratégique russe contemporaine, qui combine opérations militaires, pression énergétique et offensive informationnelle.
Un virage stratégique pour une Europe souveraine
A la lumière des injonctions tenues lors du Sommet de l’OTAN à La Haye le 24 juin dernier, le gouvernement français se met en conformité pour atteindre les 5% du PIB consacrés à la Défense d’ici à 2035.
Si l’OTAN demeure le fondement de notre défense collective, la réaffirmation de la souveraineté européenne passerait quant à elle par une autonomie à 360 degrés. Dans cette optique, le Conseil européen du 6 mars 2025, suivi du Livre Blanc pour une défense européenne à l’horizon 2030 (publié le 19 mars), témoignent d’une prise de conscience intra-européenne : politiques et citoyens s’accordent sur les enjeux que revêt la cohésion communautaire.
Ainsi, le 16 octobre dernier, Ursula von der Leyen et la Haute représentante ont proposé une feuille de route pour noter l’avancement sur les sujets prioritaires et établir les étapes à suivre, à commencer par la guerre en Ukraine.
L’UE veut renforcer sa capacité à se défendre seule avec pour mot d’ordre : investir plus, ensemble et européen. Cette démarche de souveraineté s’affirme alors même que moins de 50 % des équipements de Défense sont aujourd’hui achetés au sein de l’UE, impliquant donc un renforcement industriel conséquent.
Une Europe de la Défense s’articulerait autour de forces armées équipées, entraînées et interopérables, d’une base industrielle et technologique solide, d’un environnement civil résilient (sociétés informées, coopération civil-militaire) ainsi que d’une intégration des technologies duales (IA, cybersécurité, drones, spatial…).
Autre évolution au programme : la rédaction annuelle d’un rapport sur la préparation de la Défense sera présentée chaque octobre au Conseil européen.
Dans cette lignée, le programme SAFE “Sécurité pour l’action en Europe” se veut un instrument de prêts pour la planification industrielle de la Défense, avec une enveloppe de 150 milliards d’euros pour parvenir à ériger “une Europe plus sûre, plus capable et plus unie” assure le Commissaire chargé de la Défense et de l’Espace Andrius Kubilius.
Ces accords, en effet, ne seront pas négociés uniquement avec les pays qui partagent les mêmes valeurs de l’Union (like-minded : en voie d’adhésion ou candidats potentiels à l’adhésion ou ayant conclu un partenariat de sécurité et de défense avec l’UE, au titre de la Politique de sécurité et de défense commune – PSDC). Ils s’adresseront également aux Etats qui feront preuve de proximité stratégique avec l’UE, ce qui inclut de nombreuses démocraties dans le monde, sans s’adresser ouvertement aux Américains.